Imaginez la scène. Une blague de potache qui tourne au drame : on retire la chaise à une personne… qui tombe à la renverse.
Un salarié sans chaise, c’est un salarié déstabilisé, dans une situation d’inconfort, ou pire encore, qui va immanquablement l’amener à s’interroger sur sa place dans l’entreprise, sous le regard gêné de ses collègues et dans l’indifférence appuyée de son responsable.
C’est ainsi que France Télécom appelle les salarié-es qui doivent quitter l’entreprise : les « salarié-es sans chaise », quitte à leur retirer vraiment leur chaise pour bien leur faire comprendre qu’ils n’ont plus de place sans l’entreprise.
Comment ne pas sentir l’ironie mordante de cette situation quand on voit se développer un nouveau concept de l’aménagement des bureaux high-tech qui prévoit tout simplement de ne mettre que 8 sièges pour 10 salarié-es. On imagine que certains vont venir encore plus tôt le matin pour être sûrs de pouvoir s’assoir, peut-être à coté d’un collègue qu’on apprécie, si on s’est mis d’accord la veille… Ou à l’inverse, d’autre viendront plus tard dans la journée, à inventer des stratégies pour s’approprier un siège pendant la pause méridienne… Super, le bureau devient comme le métro où l’on se bat une place assise…
A Lyon, Orange a créé un immeuble où les salarié-es sont plus nombreux que les postes de travail (8 sur 10). Ils ont leur petit casier de 50 cm par 50 cm pour ranger leur ordinateur (mais ils l’emmènent chez eux le plus souvent), leur casque et quelques effets personnels… Comme le télétravail devient la norme, on peut évidemment penser qu’ils sont nombreux à rester chez eux. Mais non, ils ne sont pas contents et se sont mobilisé pour protester contre leurs conditions de travail. Les ingrats.
A Issy-les-Moulineaux, Orange construit son nouveau siège dans la même optique : c’est le « flex-desk » ou le « free-sitting » : la flexibilité et la liberté sont garantis à tous les étages, mais cela donne un vilain goût d’instabilité pour les salarié-es.
Il y a donc une boucle temporelle entre aujourd’hui et la période terrible des années 2005 à 2010. Nous vivons dans un système qui cherche en permanence à mettre les salarié-es en situation de stress, pour qu’ils soient plus performants, plus inventifs, plus mobilisés dans leur travail … et sans aucun doute moins solidaires entre eux. Le « bon stress » est une fable inventé par les nouveaux managers, la réalité, c’est que le stress prolongé, imposé par l’organisation du travail, détruit, corrompt et asservi les hommes et les femmes.
A l’audience du 24 mai, à la lecture d’un document figurant dans le dossier d’instruction, on voit que pour déstabiliser les salarié-es que l’on veut faire partir, il faut leur retirer la chaise. C’est l’entrée obligatoire dans le changement, un changement qui mènera vers la porte de sortie si le manager saura rester ferme pour « accompagner » le salarié dans la « vallée du changement » (sic).
Et lorsque la juge commente un document qui prévoit que certains salarié-es n’iront pas « jusqu’au bout » du changement, elle demande à Louis-Pierre Wenes d’expliquer le sens de cette formule et s’inquiète du sort de ces salarié-es réfractaires. Et Louis-Pierre Wenes répond qu’on accompagne toujours les salarié-es dans le changement et pour persuader son auditoire qu’il est sincère, il demande avec emphase qu’on ne lui retire pas, à lui, sa « part d’humanité ». Et face aux rires de la salle il se retourne et dévisage les premiers rangs des parties civiles, menaçant.
On ne devient pas un agneau si facilement.
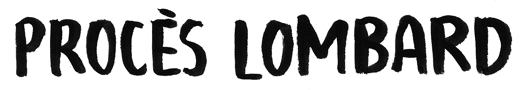


Nous sommes depuis le début de ce procès, dans la « banalité du mal » , concept développé par Hannah Arendt en 1963.
Explication de Patrick Pharo :
« L’expression banalité du mal ne peut se comprendre que comme une façon de décrire les routines par lesquelles ceux qui recourent à la violence, comme ceux qui en sont témoins, mettent en suspens leurs convictions morales et renoncent à l’examen de leur engagement pratique personnel1. »