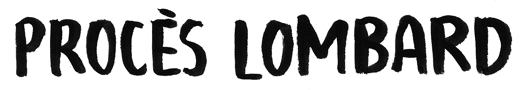Qui est responsable ? Accusation, défense et personnification du management capitaliste
mercredi 18 mai Alexis Cukier
Nous entrons dans la salle d’audience. Au-dessus de la présidente du siège, Pascaline Chamboncelle-Saligue, un écran blanc affiche la projection d’un tableau indiquant une partie de la chronologie des faits en cause – la partie la plus visible met côte à côte les noms et brèves présentations des victimes, pour l’essentiel les salarié.e.s de France Télécom qui se sont suicidé.e.s ou ont tenté de se suicider, dont il a été question le matin. Cet après-midi porte sur les alertes, il s’agit de répondre à ces questions: que savaient les prévenus? Qu’ont-ils et elles contribué à mettre en œuvre pour répondre à ces alertes? Et de quoi précisément sont-ils et elles responsables?
J’assiste pour ma part au long, et glaçant, interrogatoire de Louis-Pierre Wenès, directeur général adjoint en charge des opérations France jusqu’en octobre 2009. Le prévenu était alors n°2 du groupe et donc bras droit du PDG Didier Lombard, en charge de la mise en œuvre au niveau opérationnel du plan NExT (et son volet social, programe Act) qui visait à organiser les départs volontaires de 22.000 salarié.e.s. Ce plan est au cœur du procès, car il a constitué le principal instrument du «harcèlement moral institutionnel», pour reprendre le terme retenu en première instance, ou du «management par la terreur», pour reprendre le terme de l’une des victimes, dans l’entreprise France Télécom. Louis-Pierre Wenès est donc un cadre de haut niveau, centralement mis en cause lors du procès – ses réponses sont soigneusement pensées: intelligentes, méthodiques, parfois cinglantes. Dans ses réponses, il alterne, de manière très habile, entre la posture du simple opérationnel quand il s’agit de renvoyer la responsabilité aux Ressources Humaines, et la posture du dirigeant quand il s’agit de défendre qu’il n’y a rien eu, à France Télécom, entre 2007 et 2009, que du business as usual. Mais au fil des questions de la présidente puis des parties civiles, progressivement, ces deux discussions, l’une très singulière et l’autre très générale, tendent à devenir indissociables : de quoi Louis-Pierre Wenès est-il responsable? À quoi sert le management capitaliste ? Et au fur et à mesure que je l’écoute, il me semble que le prévenu ne plaide pas seulement sa cause: en contestant les charges retenues contre lui dans sa mise en examen, c’est au-delà une défense globale du management capitaliste qu’il présente.
C’est une étrange métamorphose qui me paraît se dérouler devant nous: le prévenu, face à la présidente qui orchestre les débats et donc dos au public, se transforme en représentant de sa classe. Est-ce de la classe capitaliste, même si lui-même n’en fait pas à proprement parler partie, ou de la classe managériale même si sa défense l’emporte parfois au-delà de la simple argumentation gestionnaire ? En tout cas, celui qui était d’abord le très efficace «cost killer» engagé par Thierry Breton en 2003 pour mettre en place un plan massif d'économies (15 milliards d’euros) sur les achats au sein du groupe de télécommunications, s’exprime aujourd’hui en véritable dirigeant, qui défend sa conception de ce que doit être une entreprise, et de ce qu’est la rationalité managériale. En suivant de manière chronologique, et aussi précise que possible, le déroulement de l’audience, je propose dans cette chronique de restituer ses propos et de les décrypter à partir de cette impression, qui me paraît se confirmer au fur et à mesure des questions et des réponse: Louis-Pierre Wenès, ici et maintenant, se met à personnifier le management capitaliste pour en défendre la cause.
En quoi consiste, dès lors, sa défense du management capitaliste, et accessoirement de lui-même ? C’est la deuxième ligne directrice qui a guidé cette chronique : j’essaierai de montrer qu’on peut la comprendre à partir de ce que la théorie marxiste a appelé la réification. Le prévenu, en effet, présente les relations entre les personnes comme des choses: pour répondre aux principales questions qui le mettent en cause, il défend qu’étant donné les contraintes économiques, et les indicateurs et chiffres disponibles au sujet des situations humaines dont il disposait, il n’était pas possible d’agir autrement qu’il ne l’a fait. Ce faisant, les drames humains semblent devenir dans son langage des effets secondaires, latéraux, de méthodes d’organisation impersonnelles et inquestionnables – jusqu’à ce que finalement le jeu des questions et des réponses conduise l’interrogatoire à exprimer quelque chose de la dure réalité dont dépend cette idéologie managériale, celle de la guerre économique au cœur du capitalisme. « C’est anxiogène, mais c’est la réalité »
Le prévenu doit commencer par répondre à la présidente du siège. Pour introduire la question des alertes, elle rappelle quelques éléments du rapport du 10 février 2010 de l’inspectrice du travail, Sylvie Catala, notamment au sujet des plans NExT et Act. La présidente souligne l’insistance de l’inspectrice du travail sur la brutalité de la restructuration et la grande rapidité des mobilités induites par ce programme de reclassement. Elle rappelle aussi l’objectif financier: il s’agit d’augmenter la rentabilité de 15% en 3 ans, entre 2006 et 2008. Elle résume enfin le diagnostic de Mme Catala: ces objectifs et ce plan ont fait passer l’entreprise d’une situation de planification stable à une succession d’ajustements très rapides dans un environnement instable. Et on en arrive à l’essentiel pour cet après-midi: le rapport de l’inspectrice du travail indique très explicitement les nombreuses alertes concernant la souffrance des salarié.e.s – alertes des CHSCT (64 expertises entre 2005 et 2009) et du CNSHSCT, de la médecine du travail, de l’Observatoire du stress et des mobilités forcées crées en 2007 à l’initiative de deux syndicats de France Télécom (Sud et CGC), des organisations syndicales ainsi que de la justice (dans les cas où l’entreprise a contesté le droit à l’expertise des CHSCT motivée par un risque grave).
Pour répondre à ces rappels, le prévenu commence par affirmer à nouveau son rejet des conclusions de ce diagnostic, en regrettant au passage l’absence d’une enquête plus approfondie de l’inspection du travail. L’objectif de ses réponses, comme au procès en première instance, est clair: contester le caractère systémique et institutionnel du harcèlement moral induit par les politiques managériales auxquelles il a pris part dans ses fonctions. En bon rhéteur, Louis-Pierre Wenès annonce d’emblée les deux principales lignes de son argumentation : 1. concernant les causes, il n’y a pas eu, entre 2007 et 2009, de «réorganisations multiples et désordonnées» dans France Télécom, mais une série de réorganisations normales, rendues nécessaires comme dans toute entreprise par les impératifs du contexte économique; 2. concernant les effets, «il n’y a pas eu de crise des suicides à France Télécom», mais seulement les conséquences inévitables d’une conjoncture difficile, anxiogène pour certain.e.s, qui a conduit les plus fragiles à ce qu’il nomme des «événements graves et malheureux». Comprenons ses propos: dans un contexte de compétition capitaliste (rappelons que France Télécom a été privatisé en 2004), le management a pour fonction normale d’ajuster l’organisation du travail à l’environnement – et c’est aux individus de s’adapter, s’ils et elles en sont capables. Dès lors, selon le prévenu, on ne saurait tenir la logique managériale, que les individus comme lui ne font qu’appliquer, pour responsable des souffrances et des suicides des salariés concernés par la restructuration. Il me semble souvent percevoir dans ses propos ce sous-entendu: je ne suis pas responsable des souffrances et des morts, sauf si vous considérez – hypothèse bien entendu tenue par le prévenu pour absurde dans un tribunal – qu’en est responsable la logique même du management capitaliste...
Considérons plus en détail son argumentation. Louis-Pierre Wenès commence par exposer, assez longuement, les causes habituelles des réorganisations dans toute grande entreprise: il faut s’adapter à l’environnement (par exemple ouvrir et fermer des boutiques en fonction de la fréquentation des clients), faire face aux baisses de ressources liés à ces évolutions (la fin des renseignements téléphoniques), rationaliser les opérations (par exemple réduire le nombre de petits sites pour faciliter la gestion globale des équipes), répondre aux évolutions des métiers (pour installer la fibre par exemple). Décryptons: ce sont les règles du jeu normales de la compétition et de l’innovation capitalistes qui sont responsables du contexte anxiogène ayant conduit aux dépressions et suicides – le management, lui, est là pour atténuer le choc et faciliter les adaptations. Donc le prévenu n’est pas responsable des charges dont on l’accuse.
Une expression de Louis-Pierre Wenès me paraît frappante. Il l’exprime plusieurs fois: on a tort de lui imputer la responsabilité d’un harcèlement institutionnel, qu’il comprend comme une volonté délibérée de déstabiliser les salarié.e.s, car cela aurait été «contraire à tous mes intérêts». Mais de quels intérêts s’agit-il? Ou plutôt: sont-ce vraiment ses intérêts personnels et professionnels ou bien les intérêts d’autres que lui, qu’il défend, et dont il se fait aujourd’hui l’avocat? Sa réponse, qui revient invariablement, ne permet pas vraiment de trancher: ses intérêts sont ceux de l’entreprise, affirme-t-il. Et c’est d’ailleurs pourquoi les charges retenues contre lui sont injustes. La société était dans une situation difficile, rappelle à plusieurs reprises le prévenu, et «nous avons fait tout ce que nous avons pu » pour aider les collaborateurs.ices et sauver l’entreprise.
Face à cette argumentation générale, exposée de manière méthodique, parfois comme un cours de théorie de l’entreprise, la présidente insiste sur les cas particuliers: celui de Michel Deparis déjà évoqué le matin, mais aussi de Yonnel Dervin, dont il est rappelé qu’il a subi six réorganisations entre avril 2007 et décembre 2008, et qu’un manager de proximité (l’un des 4000 embauché.e.s pour mettre en place le plan NExT), sous les ordres du prévenu, lui annonce dans cette période que ses «compétences ont atteint leurs limites». Yonnel Dervin tente de se suicider le 9 septembre 2009 en se plantant un couteau dans le ventre au cours d’une réunion lors de laquelle sa mutation lui est annoncée… Mis devant ce fait, ou d’autres du même type, le prévenu répond d’abord, plusieurs fois, qu’il faut de «l’humilité face à «la complexité des situations». En l’occurrence, qui sait, demande-t-il, combien de réunions Monsieur Dervin avait déjà eu avec ce manager, ce qui s’y est dit, et pourquoi ce dernier a employé cette expression que le prévenu semble estimer certes malheureuse, mais peut-être légitime ? Mais là encore, l’argumentation de Louis-Pierre Wenès redevient aussitôt plus systémique. Il reconnaît qu’il peut y avoir, ici ou là, des défaillances: «on déplace 500 personnes, il peut y avoir des couacs» ; et je me rappelle qu’en ce moment, comme en d’autres, je pense à cette expression pour décrypter son argumentation : «on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs». Ces «couacs» doivent rester isolés mais sont inévitables, affirme le prévenu. Mais Louis-Pierre Wenès ne s’en tient pas non plus à cet argument des dommages collatéraux: face à l’accusation d’un harcèlement moral institutionnel, c’est la valeur même du management capitaliste qui doit être défendue.
Or cette logique, précise le prévenu, celle qu’il a voulu voir présider notamment au plan NExT, c’est celle de l’empowerment. Le terme ici a de quoi surprendre! Par un de ces formidables retournements du sens des mots dont la novlangue managériale a le secret, «l’empowerment», initialement utilisé dans les luttes populaires pour les droits civiques aux États-Unis afin de désigner un processus d’augmentation du pouvoir d’agir de celles et ceux d’en bas, en vient à désigner la rationalité bien comprise du management capitaliste. La logique est simple, explique le prévenu: puisque le contexte économique (donnée absolue et inquestionnable de l’équation) exige 22.000 départs volontaires, le bon manager – plutôt que d’imposer par en haut des reclassements et des mobilités, et donc de reconduire la vieille logique du «taylorisme» – doit s’appuyer sur la responsabilité, la créativité et l’autonomie des salarié.e.s. Ainsi, affirme-t-il, «la philosophie de NExT», c’était l’empowerment: il s’agissait de «faire tomber les barrières qui empêchent les salariés d’utiliser leurs créativités». On retrouve ici la logique de l’injonction à l’autonomie sans moyens pour la réaliser que la sociologie critique du travail, et par exemple les travaux de Danièle Linhart, ont analysé en détail.
Le plaidoyer du prévenu, par son caractère systémique, montre bien la logique interne de cette rationalité: c’est une idéologie certes, mais pas au sens courant de préjugés et de croyances, c’est une idéologie au sens de Marx, une illusion certes mais une illusion nécessaire dans le cadre du fonctionnement du capitalisme contemporain. Puisque les objectifs financiers ne peuvent pas être remis en cause, il est nécessaire que l’organisation du travail soit conformée, d’une manière ou d’une autre, à ces objectifs – mais puisque, comme l’exprime Louis-Pierre Wenès, nous ne sommes pas en Chine, et donc que le taylorisme (ou ce qu’il pense être le taylorisme) n’est plus possible, alors il faut que les salariés s’adaptent aux objectifs par eux-mêmes. La présidente s’étonne elle aussi: cette autonomie de l’empowerment n’est-elle pas une fiction, en décalage complet avec la réalité, ce qui est encore plus anxiogène ? Le prévenu répond: non, cela n’a rien d’une fiction, c’est la logique même du management moderne – et il résume, pour bien se faire comprendre: ce qui a été mis en œuvre avec NExT «c’est une approche plus respectueuse qu’un PS».
Au terme de ce premier moment de l’interrogatoire, Pierre-Louis Wenès semble avoir réussi, sans doute de manière tout à fait délibérée et préméditée, à conduire la discussion de l’examen pratique des manquements du prévenu face aux multiples alertes concernant les effets pathogènes du plan NExT et donc de sa propre responsabilité vers une conversation d’ordre théorique au sujet de la théorie du management capitaliste... On passe alors à une nouvelle étape de sa défense. D’un côté, pour le prévenu, ce qui relève des cas particuliers, des victimes, n’est pas de sa responsabilité, mais de celle de ses inférieurs hiérarchiques, les managers au contact du terrain, ou bien d’Olivier Barberot, Directeur des Ressources Humaines au moment des faits mis en cause. Rappelons que ce dernier n’a pas fait appel, et est donc le grand absent du procès, ce qui permet manifestement aux autres prévenus de renvoyer à sa parole quand ils sont mis en difficulté («Il faudrait demander à M. Barberot, qui malheureusement n’est pas là» déclare par exemple le prévenu). D’un autre côté, ce qui peut être vu comme anxiogène pour les salariés ou délictueux pour l’entreprise, ne relève pas selon lui de sa compétence: l’opérationnel, mais plutôt du contexte économique ou des ressources humaines.
Un nouvel argument apparaît alors, qui semble d’abord desservir le prévenu mais qui ajoute finalement une corde à l’arc de ce qui paraît parfois devenir une contre-attaque: en réalité, le financier serait, dans l’entreprise capitaliste, soumis à l’opérationnel. L’occasion de développer cet argument est donné par la présidente, qui revient sur l’objectif d’accroissement de la productivité de 15% en 3 ans. Le prévenu répond;: NExT n’était pas un plan financier, ne relevait pas d’une logique financière mais opérationnelle. Car en réalité, à France Télécom comme ailleurs, selon Louis-Pierre Wenès, «le financier est le résultat de l’opérationnel». Ou plutôt, précise-t-il, c’est ainsi que cela devrait toujours être, et d’ailleurs «je n’ai jamais accepté que le financier commande à l’opérationnel». Or, d’un point de vue opérationnel, la seule «question de fond» est celle-ci: «aurions-nous pu éviter ces départs?» (les 22.000 départs volontaires et reclassements en interne ou en externe de France Télécom). La réponse est bien entendu négative pour le prévenu. La question rhétorique sert à renforcer l’effet de réification, constant dans son discours: on ne peut rien faire face aux lois économiques du capitalisme, qui sont présentées ici comme des choses. Louis-Pierre Wenès précise d’ailleurs: «c’est anxiogène, mais c’est la réalité».
Comprenons. Si le capitalisme est brutal, confronter les salarié.e.s à des situations stressantes, déstabilisantes, ce ne peut être de la responsabilité des top managers, et a fortiori du prévenu – qui n’aurait eu à cœur, à l’entendre à ce moment de ses réponses, que de réduire l’anxiété» en redonnant du pouvoir de décision aux salarié.e.s. Pour le prévenu, les suicides sont donc des accidents, liés à la fragilité des victimes: «l’environnement est inconfortable» pour tout le monde mais «certains se mettent dans des situations gravissimes, à cause d’autres facteurs». Or face à ces «événements malheureux», il est nécessaire de garder son sang-froid, de faire en sorte que «l’émotion n’empêche pas de prendre du recul». Le prévenu finit ses réponses à la présidente du siège en précisant: «je ne cherche pas à nier la vérité», mais «la complexité des situations» (économique, opérationnelle, mais aussi psychologique donc) nécessite d’avoir une certaine humilité.
De l’argumentation de Louis-Pierre Wenès pour répondre aux questions de la présidente, je retiens deux aspects marquants, qui relèvent pour moi d’une même logique. D’abord, le prévenu défend la moralité du management capitaliste, qui a pour fonction, selon le prévenu, d’aider les salarié.e.s à trouver eux-mêmes les ressources pour s’adapter à un contexte de compétition économique et innovationnelle anxiogène. Ensuite, cette même compétition est considérée comme le point de départ absolu de la rationalité managériale: le plan de départs volontaires était absolument incontournable, et l’ampleur de la tâche rendait quelques «;couacs» ou dommages collatéraux inévitable. Au final, et même si le prévenu a manifestement évité de parler de stratégies ou de batailles, par exemple, ses réponses ont progressivement dessiné le décor d’une guerre économique, dont on sait au moins depuis Souffrance en France qu’elle ne constitue pas seulement une réalité de la concurrence capitaliste, mais aussi une idéologie qui l’accompagne. Cette rationalité, personnifiée ici et maintenant par Louis-Pierre Wenès, a pour fonction de justifier qu’il y ait nécessairement des pertes, de légitimer qu’on ne se préoccupe pas des victimes, et de contribuer à enrôler toutes et tous dans l’adaptation à cette guerre. Certaines des réactions du prévenu relèvent clairement de ce que Christophe Dejours nomme « la stratégie de défense collective du cynisme viril »: l’idéologie managériale sert à rendre les top managers et dirigeants insensibles à la souffrance des salariés subalternes (c’est l’argument de la psychodynamique du travail) mais aussi, peut-on ajouter ici, à les déresponsabiliser, d’un point de vue moral aussi bien que – du moins c’est ce que semble espérer le prévenu – d’un point de vue juridique. « Je n’avais pas de signaux qui exigeaient de moi que j’intervienne »
Les questions et remarques de la présidente sont suivies par celles des parties civiles. C’est Sylvie Topaloff, pour la Fédération syndicale Sud PTT, qui commence, en questionnant l’estimation de la situation qu’avait le prévenu à l’été 2009, suite au suicide de Michel Deparis: le prévenu pense-t-il à l’époque qu’il s’agit d’une crise médiatique ou d’une crise de l’entreprise? Louis-Pierre Wenès cherche à rester dans le même registre que dans la séquence précédente, en réitérant sa défense de la rationalité managériale: le poste de direction des opérations est nécessairement éloigné des réalités du terrain, et il n’est possible d’estimer la réalité qu’à partir des indicateurs qui lui remontent. Or ces indicateurs ne lui permettent pas à l’époque, affirme-t-il, de percevoir une crise dans l’entreprise – si bien que son estimation est en effet qu’il s’agit d’un emballement médiatique lié à la surexposition d’un suicide isolé. Certes, le prévenu affirme au détour d’une longue réponse qu’il commence à se poser quelques questions au début de l’été 2009. Mais, ajoute-t-il, «je n’avais pas de signaux qui exigeaient de moi que j’intervienne». Une autre question de l’avocate porte sur l’incompatibilité du plan NExT avec l’obligation légale de l’employeur d’assurer le reclassement de ses salariés. Les «espaces de développement», nom du dispositif dans lequel entrent les salariés qui doivent changer de poste ou quitter l’entreprise, ne sont-elles pas en réalité des «espaces de dégagement», qui permettent de contourner cette obligation fondamentale de l’employeur? Le prévenu répond, là encore, qu’il ne s’est jamais posé la question en ces termes, car il est nécessaire, à ce poste, de faire confiance aux DRH, seuls spécialistes du Code du travail et responsables de la compatibilité des décisions de l’entreprise avec la loi.
L’avocate cherche, pour finir, à ramener la discussion vers des réalités concrètes, incontournables. C’est le cas notamment de sa dernière question: quelle a été la réaction du prévenu à l’alerte du 4 juillet 2007 porté par l’ensemble des organisations syndicales, pointant que des modifications incessantes de l’organisation du travail produisent de manière systématique de l’anxiété et du stress? Louis-Pierre Wenès répond qu’il n’a «reçu aucun indicateur établissant que l’anxiété augmente», qu’il n’a donc aucune raison de penser, alors comme aujourd’hui, que son action est susceptible de créer du stress. C’est une manière de dire, bien sûr, que la parole des syndicats n’a aucune valeur pour le management, mais aussi de concéder que la rationalité néo-managériale est totalement autoréférentielle, et imperméable aux autres discours qui n’entrent pas dans ses procédures et ses indicateurs.
L’avocat de la CFE-CGC, Frédéric Benoist, continue de questionner le prévenu au sujet des connaissances qu’il prétend ne pas avoir à l’époque concernant la gravité de la situation. Mais il ajoute une remarque qui conduit là encore le prévenu à clarifier ce qu’il pense du discours des syndicats: pourquoi l’entreprise n’a-t-elle pas mis en place de concertation collective avant de mettre en œuvre le programme Act? Le prévenu rappelle que, dans la logique managériale qu’il défend (bec et ongles), les espaces de développement sont des espaces de consultation et concertation. Mais puisqu’il a bien compris la question concernant la concertation – et la présidente met les points sur les «i» en lui précisant qu’il est ici interrogé au sujet du «dialogue social» – et tout en laissant transparaître à nouveau son mépris des syndicats, le prévenu répond qu’il faudrait demander au grand absent, M. Barberot, «pourquoi il n’a pas voulu discuter avec les syndicats». On a là une nouvelle illustration du fait désormais bien établi selon lequel l’individualisation de l’évaluation comme de la concertation dans l’entreprise est une manière de neutraliser le contre-pouvoir des syndicats.
Au fur et à mesure des questions des avocats représentant les organisations syndicales (Blandine Sibenaler pour la CFTC, Dominique Riera pour FO, Jonathan Cadot pour la CFDT), qui continuent à questionner le prévenu concernant ses initiatives face aux alertes dont il peut avoir connaissance, Louis-Pierre Wenès est amené à se replier de plus en plus sur l’affirmation de son ignorance de la situation: «cela ne m’était pas remonté», «je ne me souviens pas », «je n’ai pas eu de chiffre tel que je me suis posé des questions», «la visibilité, c’est au niveau local». Cela devient compliqué pour lui, commente un membre de l’assistance, du côté des parties civiles. Je me dis que les parties civiles ont réussi à sortir le prévenu de son plan de défense. Mais le débat politique sur le gouvernement de l’entreprise est relancé par une question du ministère public: comment le prévenu explique-t-il, finalement, le nombre élevé de suicides, n’y avait-il rien là de différent par rapport à la politique managériale d’autres entreprises? A cette question directe, le prévenu répond de manière brutale: « Je ne nie pas qu’il y ait eu un certain nombre d’événements graves et malheureux. Ce que j’affirme, c’est qu’il n’y a pas eu de crise de suicides chez France Télécom. » Ces deux phrases – qui provoquent dans le public de l’audience, constitué principalement de parties civiles, une onde de réprobation teintée, me semble-t-il, d’un peu d’effroi (ou bien est-ce seulement ma propre réaction ?) – semblent faire tomber momentanément le «masque de caractère» du manager qui se prétend juste et efficace. Elles font apparaître la déraison de la rationalité néo-managériale: celle d’une logique des chiffres et des indicateurs impersonnelle, cynique, monstrueuse. C’est aussi le moment où, paradoxalement, Louis-Pierre Wenès évoque un peu (enfin) quelque chose de ses propres affects: après son départ de l’entreprise, «j’ai voulu savoir », «j’ai lu tous les chiffres publiés à l’époque»
- et on devine ici une certaine émotion. Mais la conclusion est invariablement la même: sur la base de ces chiffres, il n’y a pas eu de crise des suicides à France Télécom.
La présidente ne fait pas remarquer la déraison de cet argument, mais note tout de même au passage, de manière assez vive: «on en revient à la bataille des chiffres!». Cette phrase est sans doute anodine, mais elle me marque. Après réflexion, il me semble qu’en effet, au-delà de l’intention de sa locutrice, cette phrase exprime bien l’enjeu de cet interrogatoire. D’une part, pour le prévenu, l’essentiel de l’affaire est une question de chiffres et d’indicateurs, dont il prétend qu’ils établissent son irresponsabilité d’un point de vue professionnel, moral et juridique. Mais d’autre part, cette expression peut faire entendre aussi que, si d’un côté les bourreaux présumés prétendent avoir agi en pensant bien faire, suivant une rationalité managériale faite de chiffres et d’indicateurs, d’un autre côté les victimes sont bien mortes au cours d’une bataille économique. La bataille des chiffres, au sens métaphorique, renvoie aux chiffres mesurant les gains et les pertes de la bataille capitaliste, au sens littéral: d’un côté Louis-Pierre Wenès a contribué à faire économiser 15 milliards à France Télécom et il a participé à la mise en œuvre d’un plan de départ de 22.000 salariés; d’un autre côté, parmi les 39 victimes recensées par le parquet, 8 ont subi une dépression ou ont été mises en arrêt de travail, 12 ont tenté de se suicider et 19 se sont suicidées. Ni les chiffres, ni les morts, ne parlent – mais dans cet interrogatoire, les questions et les réponses ont permis de mieux comprendre comment on en est arrivé là. Et elles ont fait entendre – d’une manière qui, je pense, me marquera – le type de rationalité qui soutient la violence du management capitaliste.