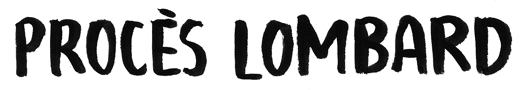L’audience du 19 mai, vue par Pascal Marichalar, sociologue et historien au CNRS. Il est notamment l’auteur de Médecin du travail, médecin du patron ? L’indépendance médicale en question (2014), et Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences sociales (2017).

Un homme en colère
Louis-Pierre Wenès, 73 ans, les cheveux blancs méticuleusement ramenés vers l’arrière, est l’ancien numéro deux de la société France Télécom. A la barre, il revendique d’être volontiers « brut de décoffrage » et de se laisser facilement emporter par la colère : « je m’arrête là, ou je vais devenir grossier », dit-il plusieurs fois.
Pourtant, à une époque où le virilisme agressif n’est plus censé avoir la cote, dans une cour d’appel où tout rappelle la déférence qu’on se doit de montrer envers la justice, ce comportement « passe » sans remontrances excessives, comme une caractéristique pittoresque, pagnolesque, du personnage. Lorsqu’on a assisté à d’autres procès, on se rappelle que tous les prévenus ne sont pas logés à la même enseigne.
L’ex-dirigeant ne semble pas habitué d’être ainsi interrogé par des femmes. Il y a d’abord la Présidente de la cour, qu’il interrompt volontiers, quand il ne prétend pas lui donner des leçons. Lorsqu’elle lui fait remarquer que finalement, 350 salariés suivis par des « cellules d’écoute et d’accompagnement » sur les 22000 agents poussés vers la sortie, c’est peu, il l’accuse de procéder à une « généralisation audacieuse ». Elle n’aurait pas les moyens de « dire que les 22000 salariés ont souffert ». La juge le recadre gentiment : « Ce sera à nous d’en juger, monsieur ».
Et puis il y a l’avocate des parties civiles, Maître Sylvie Topaloff,dont les questions semblent embêter prodigieusement l’ex-n°2. Le dispositif de la cour fait que Wenès lui tourne le dos, puisque ses réponses sont censées être adressées aux juges. « Je ne sais pas si vous avez décidé de ne pas me répondre ou si vous réfléchissez », le pousse-t-elle alors qu’il reste muet. A un autre moment, elle bute sur le mot « décorrélé », en le prononçant « décoléré », et il ressort son couplet sur le fait que s’il y en a un qui mérite d’être en colère, c’est lui. « Et moi donc », rétorque froidement l’avocate des familles de suicidés, laissant s’installer un long silence avant de reprendre l’interrogatoire.
Dans la cellule
Les débats de la matinée portent donc sur les fameuses « cellules d’écoute et d’accompagnement » des employés de France Télécom mises en place en 2007. C’est un point plus important qu’il n’en a l’air. Le dispositif a-t-il été mis en place pour « gérer » les effets pathogènes du plan de réduction d’effectifs ? Pour contrer le message porté par l’Observatoire du stress et des mobilités forcées, monté au même moment par les syndicats ? Ou, de façon déconnectée de l’actualité, simplement pour ajouter une corde à l’arc de la prévention des risques professionnels ?
Chaque réponse qui peut être apportée est potentiellement dangereuse pour les prévenus. Soit ils reconnaissent qu’ils ont installé ce dispositif parce qu’ils étaient au courant des effets anxiogènes de leurs réformes – et pourtant, ils ne se sont pas privés de les mener à terme. Soit ils plaident la coïncidence temporelle fortuite – mais dans ce cas, ils reconnaissent qu’ils étaient aveugles aux effets néfastes des réorganisations sur les conditions de travail, en infraction avec les textes de loi.
Nathalie Boulanger a été la première à parler ce matin. L’ex directrice des actions territoriales explique le dispositif de ces « cellules » qui rassemblaient des médecins du travail volontaires –tous ne l’étaient pas, loin s’en faut –, des membres des ressources humaines, des chefs d’équipe, avec l’idée d’offrir un lieu d’écoute aux salarié·es en souffrance, sur la base du volontariat. Elle dit que c’était une initiative de M. Wenès.
Le ministère public s’interroge : « Quand M. Wenès vous a demandé de mettre en place ces cellules, comment vous les a-t-il justifiées ? » Vu qu’il est dit qu’à l’époque, il n’y avait pas de perception d’un malaise généralisé. Mme Boulanger confirme, il n’a pas parlé de malaise généralisé, mais simplement du fait qu’il y avait « des salariés qui étaient en souffrance ». Un pluriel, certes, mais un pluriel qui prétend ne rien suggérer de plus que l’addition de souffrances individuelles.
Tout le débat se porte en effet bien vite sur l’opposition entre l’individuel et le général. Comme l’explique Maître Topaloff à l’ex directrice : « vous comprenez que le soupçon existe que ces cellules étaient une façon de court-circuiter les organisations syndicales ». Ne s’agissait-il pas d’une « course à la montre » avec l’Observatoire monté par les syndicats ? L’avocate cite un document managérial de l’époque qui explique que si on laisse champ libre aux syndicats, il y a un « risque de passage de l’individuel au collectif ».
Louis-Pierre Wenès est prêt à reconnaître que les cellules étaient de son initiative. C’était un ami de sa femme, le psychologue Roland Guinchard, qui lui en avait soufflé l’idée. M. Wenès l’a alors chargé de mettre en place le dispositif, d’abord dans deux directions territoriales, puis au niveau national.
Comme le rappelle Sylvie Topaloff, M. Guinchard n’est pas n’importe quel psychologue. Il est résolument du côté de l’individuel plutôt que du collectif. L’avocate explique que quelques années après ces événements, M. Guinchard a publié un livre au titre révélateur : Les personnalités difficiles ou dangereuses au travail : identifier les comportements et gérer les troubles (Elsevier Masson, 2013). Il n’est pas invraisemblable de penser que les « cellules » avaient été conçues dans le même but, celui de traiter tous les problèmes comme s’ils étaient uniquement dus aux inimitiés particulières et aux défaillances privées.
« Cellules : le terme était polysémique », se lamente Jacques Moulin, ancien directeur territorial de la grande région Est. C’est pourquoi il lui a finalement préféré celui d’ « espace », supprimant la connotation carcérale, et permettant selon lui « l’appropriation par le salarié ». Coupe de cheveux à la mode, vêtu d’une veste à carreaux cintrée, M. Moulin est fascinant à écouter. On dirait quelqu’un qui passe un entretien d’évaluation avec son n+1. Nulle volonté de marquer une distance au rôle de manager, bien au contraire, M. Moulin donne l’impression qu’il vit pour ce rôle. Lorsque la présidente lui reproche de rester trop formel et théorique dans l’évocation des dispositifs – « ce ne sont que des mots », dit-elle – il s’insurge de manière théâtrale. Il s’embarque dans une laborieuse anaphore : « Madame la Présidente, derrière mes mots, il y a quatre médecins du travail », « derrière mes mots il y a… », etc., etc. Il conclue son énumération liste avec superbe : « non, Madame la Présidente, ce ne sont pas que des mots, ces dispositifs étaient incarnés ». Il n’empêche, on ne chassera pas l’impression qu’il n’a fait que décrire un organigramme, une institution de papier. On peine à comprendre ce que ces cellules/espaces pouvaient faire concrètement pour un agent en souffrance – par exemple, lorsqu’elle ou il avait été muté dans un nouveau métier, un nouveau secteur géographique, contre sa volonté.

Le film interdit
L’après-midi, un petit air de festival de Cannes. Dans la salle immense qui a un air d’église, la centaine de personnes présentes s’est tue et les majestueux candélabres ont été éteints. L’atmosphère est étouffante et le public agite des éventails de fortune. On est allé chercher la clé USB dans le coffre-fort où elle était conservée à l’abri des convoitises. Depuis sa réalisation il y a douze ans, le film n’a été montré en public qu’une seule fois. Il est pourtant l’œuvre d’un réalisateur de documentaires connu, Serge Moati.
A l’origine, cela devait être un « film d’entreprise ». Son titre est pourtant loin d’un éloge du succès : « France Télécom : chronique d’une crise ». La Présidente prévient : le long-métrage est « la propriété » de la société Orange, il ne faut pas qu’il soit montré en dehors de cette salle d’audience, jamais. Les gendarmes quadrillent l’assistance, car la juge leur a demandé d’être « particulièrement vigilants » à ce que personne n’ait un téléphone ou ordinateur portable à la main qui pourrait servir pour un captage pirate.
La Présidente commence alors à lire un texte écrit à la demande de la défense par un certain Ted Anspach, réalisateur de documentaires pour la télévision. Celui-ci qualifie son écrit d « avis technique » sur le film que nous nous apprêtons à voir, plutôt que de point de vue critique ou d’opinion subjective. L’avis est assassin : le long métrage « n’obéit pas aux codes de l’enquête journalistique ». Déséquilibré, il offrirait une place disproportionnée au point de vue syndical plutôt qu’à celui de la direction. Après avoir vu tant de témoignages de souffrance, évidemment que « le spectateur est prisonnier de son empathie », nous met en garde M. Anspach.
Le réalisateur a demandé un droit de réponse, que la Présidente nous lit en suivant. Le propos est bref. Moati trouve les mots de son collègue particulièrement « injustes et blessants », et rappelle qu’il « ne filme jamais en cachette ni par surprise ». Au début des années 2010, il a adressé le film monté à la direction qui le lui avait commandé, sans en garder de copie. Il n’en a plus entendu parler, et pour cause, puisque la direction de France Télécom Orange, après l’avoir visionné en petit comité, a immédiatement choisi de l’enterrer. Jusqu’à ce jour du printemps 2019 où la presse a rapporté que le film, miraculeusement échappé d’un premier coffre-fort, avait été projeté lors du procès en première instance.
Le film est lancé. Violons festifs, et immédiatement la voix off de Moati. Il rappelle les circonstances de la commande au printemps 2009. C’est lors d’un dîner chez un ami commun que le PDG de France Télécom Didier Lombard et le réalisateur se sont rencontrés. Moati accepte le projet et commence à tourner.
Du point de vue de la stratégie de communication de l’entreprise, le timing ne pouvait être plus désastreux. En effet, quelques semaines plus tard, c’est le début d’une médiatisation intense des suicides d’agents et de salariés de l’entreprise, en une de tous les journaux télévisés de France puis du monde. Comme l’explique la voix off, « je suis rattrapé par l’histoire, et quelle histoire… ». On voit alors Moati rediscuter avec Lombard du statut du film, étant donné le changement de contexte.
« C’est les accords qu’on avait au début, hein », lui dit le PDG. Des propos que Moati interprète comme le gage d’une confiance renouvelée : « pour moi, j’ai carte blanche ». Désormais, il va faire le tour de France pour tirer cette affaire de suicides au clair.
Dans le genre bien particulier du documentaire sur les conditions de travail dans une entreprise, celui-ci est un petit bijou, bien loin de la présentation caricaturale faite par T. Anspach. C’est que Serge Moati a réussi à gagner la confiance à la fois de la direction et des salariés, ce qui n’est généralement pas possible lorsqu’il y existe un conflit du travail important.
Contrairement à ce que prétend « l’avis technique », les interviews des managers les plus éminents forment une large part du film – de Delphine Ernotte et Laurent Zylberberg à Stéphane Richard, en passant par Louis-Pierre Wenès, l’un des prévenus du procès actuel – et tous semblent parler à Moati à cœur ouvert (après tout, le PDG ne s’en porte-t-il pas lui-même garant ?). On est stupéfait des moments d’introspection face caméra, des reconnaissances spontanées de responsabilité ou de négligence. Sans doute qu’en 2009-2010, la possibilité d’un procès pénal les mettant en cause n’était même pas dans le domaine de l’imaginable.
La parole des salarié·es est elle aussi étonnamment libre face à un réalisateur qui est pourtant, officiellement, envoyé par le PDG. On comprend que c’est le contexte exceptionnel de médiatisation des suicides qui protège ces femmes et ces hommes des représailles habituellement intentées contre les porteurs d’une parole trop franche sur les dysfonctionnements de l’organisation.
L’une des premières scènes montre Moati agenouillé auprès d’un agent de centre d’appel, qui lui explique qu’il a désormais honte de son travail et n’en parle pas à sa famille, surtout pas. Les mots sont confiés à voix basse, comme le ferait un dissident dans un régime de surveillance, tandis que quelques mètres plus loin, la délégation managériale avec laquelle est venu Moati semble s’inquiéter de ce conciliabule, sans pour autant oser l’interrompre.
Le documentaire rappelle les grandes étapes de la privatisation de la société France Télécom – initiée par le ministre des télécommunications François Fillon en 1996, poursuivie sous les socialistes, achevée lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l’économie. Il montre les effets délétères du changement de paradigme sur le moral des agents : les usagers deviennent des clients, le service devient de la vente, il faut faire du chiffre y compris en vendant des téléphones ultra-sophistiqués à des personnes âgées qui n’en auront aucun usage. Centrant son propos sur les centres d’appel, parce que c’est là que le malaise lui semble le plus palpable, Moati pointe du doigt les ravages des « scripts » ou scénarios, qui codifient tout ce que les salariés sont censés dire au mot près, leur donnant l’impression d’être des robots.
Le réalisateur parvient à donner la parole à des travailleurs·ses syndiqué·es et non syndiqué·es de tous échelons, qui témoignent toutes et tous d’un certain mal-être. On éprouve de l’empathie pour ces femmes qui se sont battus pour garder ouvert leur centre de Marignane en dépit des pressions vers la réduction des effectifs, mais aussi pour le directeur d’une unité dont un salarié s’est suicidé, et à qui la famille a dit qu’il n’était pas le bienvenu aux obsèques, ce qu’il n’a pas compris.
La liberté de se suicider
Au final, quelle est l’utilité du film dans le cadre du procès ? D’abord de donner à vivre l’atmosphère de ces années, en fournissant une photographie de l’état d’esprit d’alors des différents protagonistes.
Les propos tenus par les prévenus ne les dépeignent pas sous le meilleur jour, c’est le moins que l’on puisse dire. Ainsi par exemple, lorsque Louis-Pierre Wenès feint de demander à Serge Moati de se jeter par la fenêtre. Qu’il ait décidé de ne pas le faire, voilà la preuve de la liberté humaine : « Quoi, d’un seul coup, les hommes n’ont plus le libre arbitre ? Les femmes n’ont plus le libre arbitre ? », assène le manager sur le ton de l’évidence. Wenès explique encore que « ce n’est pas la compassion qui règle la souffrance », et qu’il n’y a aucune pitié dans le monde de la concurrence capitaliste : « s’ils croient que les Chinois vont faire preuve de pitié… » Quand à Didier Lombard, dans l’une des premières scènes, il reconnaît qu’ « en fait, le sujet c’est : est-ce que vous êtes capable de faire de l’économique et de l’humain en même temps. Et c’est ça la marche qu’on a ratée ».
Pour autant, Moati n’identifie pas encore ce que le rapport de l’inspectrice Sylvie Catala va pointer du doigt en 2010, à savoir que le mal-être des agents de France Télécom n’est peut-être pas simplement l’effet collatéral d’une mutation capitalistique, mais bien une conséquence intentionnelle d’une stratégie managériale explicite mise en place depuis 2006 sous les acronymes NExT, ACT, et visant à pousser 22000 fonctionnaires vers la sortie de leur plein gré, puisqu’elles et ils ne peuvent être licencié·es.
La Présidente insiste à plusieurs reprises sur le fait que s’il est procédé à ce visionnage, c’est uniquement parce que le film a été cité plusieurs fois dans le premier jugement. Aussi bien elle que le ministère public semblent circonspects sur l’opportunité d’utiliser les verbatims du film comme source. On nous dit que les juges du tribunal correctionnel ont été imprudents en mobilisant aussi abondamment cette pièce, qu’il faudrait au minimum avoir les rushes pour s’assurer du contexte dans lequel les propos ont été tenus. Tout ceci va dans le sens de la défense, qui assure que nombre des phrases sont tronquées. Par défaut d’actes supplémentaires, on n’en saura pas plus. Mais la charge émotionnelle du film est telle que la suspension d’audience décidée par la Présidente semble nécessaire pour tout le monde.
Un gendarme se remet dans sa posture de surveillant, debout les bras croisés, comme si de rien n’était, après avoir passé toute la séance assis sur les marches d’un escalier, entièrement absorbé par les drames à l’écran.
La médecine du travail face à un mur
L’interminable journée se termine par l’audition de témoins. J’ai pu écouter Catherine Morel, retraitée de la médecine du travail, venue raconter les deux années terribles qu’elle a passées à France Télécom entre 2007 et 2009. Elle était sur le site de Grenoble. Dès le début, elle a compris que quelque chose n’allait pas dans l’entreprise. Le nombre de visites spontanées à la demande des salarié·es était très grand. Nombreux étaient celles et ceux qui s’effondraient en pleurs dans son bureau. Ses demandes d’aménagement de poste restaient lettre morte – elle n’avait aucun interlocuteur attitré au sein de la direction.
Quand elle a pris son poste, on lui a demandé de participer aux toutes nouvelles « cellules d’écoute ». Mme Morel a étudié le dispositif et a refusé, estimant qu’il était contraire au code du travail (faisant fi de la sectorisation des médecins du travail) et au code de déontologie médicale (le respect du secret médical était plus que problématique dans cette instance associant managers et médecins). Au nom de ses collègues, elle a saisi le Conseil national de l’Ordre des médecins pour se couvrir. L’instance a confirmé ses inquiétudes. Par conséquent, ni elle ni ses six collègues n’ont accepté d’entrer dans les cellules.

(par Claire Robert)
En 2009, elle a finalement craqué, sentant que l’entreprise n’en avait que faire de la prévention des atteintes à la santé psychique des salarié·es. Elle a démissionné. Elle se sentait coupable de son
impuissance, elle s’est sentie coupable de son départ. Mme Morel a néanmoins fourni un dernier, et considérable, effort à rédiger une lettre de démission étayée, pour expliquer les raisons de son départ.
« Je n’ai pu faire que le constat d’une adaptation forcée de l’homme au travail, suite à des fermetures de service, des suppressions de poste de travail, des mutations fonctionnelles ou géographiques imposées », explique-t-elle dans cette lettre.
Deux des ténors du barreau qui défendent les prévenus tentent de la mettre en difficulté. Maître Patrick Maisonneuve lui demande comment elle peut dire que les cellules étaient un dispositif inutile, dans la mesure où elle n’y a jamais participé. Mme Morel ne se démonte pas. Elle rappelle tout ce qui existait dans le Code du travail pour permettre aux salarié·es d’exprimer leur souffrance, explique qu’après une consultation, elle ne se privait pas de saisir managers et collègues pour tenter de résoudre les situations individuelles, lorsque la victime lui en donnait l’autorisation. Elle ne voyait pas le besoin de ces cellules déconnectées du terrain (une par direction territoriale), intimidantes pour les salarié·es, sans garanties fermes de confidentialité, aux réunions épisodiques.
C’est ensuite au tour de Maître Jean Veil, qui suggère avec un sourire faussement complice que c’est peut-être le salaire de son poste suivant (un poste de médecin du travail dans un service s’occupant d’un portefeuille divers de petites entreprises) qui constitue la véritable raison de son départ. Mme Morel est outrée, mais contrairement à M. Wenès, sa colère reste froide. Elle répond non sans sourire elle-même à l’outrecuidance de l’avocat qu’elle était « très bien payée » à France Télécom – et davantage, suggère-t-elle, que dans son poste suivant, bien moins prestigieux dans le monde de la médecine du travail. Elle a pourtant beaucoup apprécié les douze dernières années de sa carrière passées dans ce service « inter-entreprises ». Au moins, lorsqu’il y avait un risque ou un problème, elle avait un interlocuteur en face d’elle, un patron en chair et en os. Ce n’était pas facile tous les jours, mais elle a pu se sentir utile. La Présidente la remercie.

(par Claire Robert)
Pour finir, c’est au tour de Pascale Abdessamad, assistante sociale, de raconter le long calvaire de son travail empêché au service des salarié·es. Description d’un monde où l’on semble avoir construit un mur de béton autour des professionnel·les de la sollicitude envers autrui et de la prévention des atteintes à la santé, afin qu’elles et ils ne viennent pas entraver le respect des objectifs économiques.
C’est l’humain qu’on a voulu enfermer dans une cellule, mais heureusement, quelque chose toujours résiste.