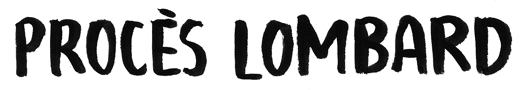Du 11 mai au 1er juillet 2022 se tient « le procès de France Télécom » en appel. Cette deuxième audience du 12 mai est vue par Louis-Marie Barnier, sociologue du travail et représentant CGT au Conseil National d’Orientation des Conditions de Travail. Il est co-auteur avec Hélène Adam de « La santé n’a pas de prix, voyage au cœur des CHSCT », Syllepse, 2013.
Patrons voyous ou politique d’entreprise ?
La juge de la cour d’appel avait décidé d’axer cette seconde journée sur l’étude de la politique sociale de l’entreprise, avec pour fil conducteur cette question qui sera précisée au cours de la journée : « Est-ce que vous avez fait le maximum en matière de dialogue social, ou bien avez-vous placé le personnel en mal de prévention ? » Le malaise tout au long de la journée provient d’un sentiment : juge-t-on l’entreprise ou bien quelques dirigeants qui auraient dépassé les limites ?
Chronologie
La journée débute par une étude du planning des différentes responsabilités des prévenus au sein de l’entreprise. L’acte d’accusation précise en effet la relaxe concernant les faits antérieurs à 2007 ou postérieurs à 2008. Il importe donc de connaitre la capacité de chacun de peser sur les évènements durant cette période de façon à fixer les responsabilités individuelles des prévenus dans ce procès. La juge interroge Wenes, directeur des achats et de l’amélioration de la performance : « Vous a-t-on donné les surnoms de ‘brute’ ou de cost-killer’ ? » On perçoit parallèlement que les processus de machine à broyer les individus, portés par ces prévenus concernant les salariés, atteint aussi ces cadres supérieurs, telle cette cadre (Boulanger) qui évoque ses problèmes avec son fils nécessitant de rester près de chez elle ; ou ce cadre (Moulin), dont le fils a deux ans, qui demande à revenir à Paris… Cette dimension humaine qu’ils ont pourtant refusée aux salariés.
Peu à peu la juge sort du bois et traque la mauvaise foi d’un prévenu : « Vous auriez pu être force de proposition concernant les risques psychosociaux ? Ou concernant le bien-être des salariés ? » Réponse : « Ce sont les directions des métiers qui décidaient, nous responsables territoriaux on pouvait seulement faire remonter des suggestions, au moins pour faciliter l’exécution du travail » (Moulin, responsable du territoire de l’est).
Effectifs
La juge se penche ensuite sur les effectifs. En 2006, un tiers seulement des salariés sont de droit privé, 60 % ont plus de 20 ans d’ancienneté. C’est autour de ces deux chiffres que l’échange se poursuit, les questions de la magistrate se font de plus en plus incisives : « Pourquoi n’avez-vous pas prolongé le dispositif permettant des congés de fin de carrière (CFC) ? De nombreuses entreprises le font en France, pourquoi pas vous ? Si vous dites que ce plan CFC s’adresse aux fonctionnaires, pourquoi n’avez-vous pas mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) parallèle permettant aux salariés de droit privé de partir dans les mêmes conditions ? Vous dites que c’est l’État qui paie, mais en fait n’est-ce pas FT dans ce cas ? »
L’absence d’un plan social visait à passer « sous les radars » du débat public. La juge lit l’audition d’un témoin sur l’intervention de Pérol, secrétaire de l’Élysée, qui voulait « une réduction sans que cela fasse du bruit dans la presse donc sans grand plan social ». « Je ne m’en souviens pas » dit Wenes, qui n’aurait jamais parlé d’emploi avec le représentant de l’Élysée ! Pour Lombard, ce refus par l’État est « une faribole »…
Cependant, le débat se polarise très vite sur la période cruciale de 2006 et plus exactement sur le point de basculement du 14 février 2006 où fuite dans la presse l’annonce de la volonté de supprimer 22 000 emplois. Les échanges permettent ainsi de revenir sur la longue négociation de l’accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs (GPEC) qui a duré d’octobre 2005 à février 2006, pour finalement aboutir à un pâle accord en mars 2006, signé par un seul syndicat (la CFTC, qui signale en parallèle avec sa signature son opposition aux 22 000 suppressions d’emplois). Les syndicats SUD et CGT, représentant la majorité du personnel, s’opposeront à cet accord dont la direction appliquera cependant les mesures par décision unilatérale, sans rouvrir de négociation GPEC. Comme le dit l’Ordonnance de renvoi devant cette cour d’appel, « les dirigeants de FTSA ont délibérément fait échouer les négociations avec les organisations syndicales pour exclure ces dernières du contrôle de l’application des mesures du plan Act et imposer une décision unilatérale (…) qui leur a permis de disposer d’un cadre juridique adapté à leur politique de déflation » (p 603). La magistrate se penche aussi sur le volontariat supposé des salariés. Wenes rétorque : « Personne n’est parti s’il a dit non ». La juge porte le fer : « N’était-ce pas des volontariats imaginés ? »
La juge pointe l’absence de PSE qui vise à protéger les salariés, liée au refus du dialogue social : « Comment préparez-vous les salariés à ce choc des suppressions d’emploi ? » L’institut des métiers organise un colloque « Éviter les exclusions sociales internes », qui publie une plaquette en papier glacé. Question : la plaquette a-t-elle été diffusée ? Cherouvrier (président du CCE à cette époque) en déduit : « Vous ne pouvez pas dire qu’on n’a rien fait ». « Mais est-ce en rapport avec le besoin ? », répond la juge. Confirmation donc d’un point de l’accusation : « Le déni assumé par les dirigeants de leur politique de déflation leur a permis d’organiser la suppression de 22 000 postes sans respecter les procédures d’information et de consultation qui auraient imposé à n’importe quel dirigeant d’une entreprise privée de s’expliquer devant les instances représentatives du personnel (IRP), notamment sur la nature et le nombre des emplois et postes de travail impactés, sur le nombre et le profil des personnels potentiellement touchés, sur les recherches et le suivi des mesures d’accompagnement, et éventuellement de reclassement ; sur l’établissement des critères d’ordre des licenciements etc. »
La juge rappelle le rôle privilégié des CHSCT concernant des salariés « en mal de prévention ». Les refus répétés d’expertise votés par les CHSCT sont justifiés par les prévenus : cela concernait des cas individuels, ou bien c’était des décisions générales à traiter ailleurs. Et quand un avocat demande si aujourd’hui, avec le recul, les prévenus ne pensent pas que c’était une erreur d’appréciation, un prévenu répond qu’ils appliquaient le droit. Droit dans ses bottes !
Mais voilà, la dette de FT plane sur l’entreprise. Lombard, pour qui il n’a jamais été question de faire un PSE, explique qu’il fallait récupérer 7 Md par an dans une entreprise qui coulait. Cri du cœur de ce cadre : « Le bien-être d’une personne c’est microscopique par rapport à ça ! »
Juger l’entreprise à travers ses responsables ou emprisonner des patrons voyous ?
Comme l’a signalé le procureur, les prévenus ont été relaxés des atteintes au droit du travail, ne restent donc que les infractions relevant du code pénal. De plus, l’entreprise n’ayant pas interjeté appel, seuls figurent à la barre six anciens responsables de l’entreprise, visiblement toujours aussi convaincus d’avoir seulement dû répondre à des contraintes extérieures.
Deux interprétations peuvent donc coexister dans ces débats du procès. Une première lecture pourrait en rester à l’expression de « patrons voyous », accusés d’avoir dépassé le trait par rapport à d’autres patrons. Il faudrait juger des hommes et femmes qui ont été polarisés par les chiffres. Une autre se centre au contraire sur la figure de l’employeur, et pas seulement du système. Cette seconde approche permet d’affiner notre compréhension des approches de la santé au travail et des politiques de prévention en entreprise.
Dans ce procès pénal hors du commun de dirigeants d’entreprise, l’employeur n’est pas seulement une « personne morale » (dont les pratiques sont par ailleurs souvent amorales !), c’est aussi une personne physique qui doit rendre compte de ses décisions. C’est ainsi que le CHSCT en son temps, puis aujourd’hui le CSE, doit vérifier que son interlocuteur, le président du CSE, a bien une délégation de sécurité lui donnant la possibilité d’interrompre immédiatement une situation de danger, et rendant compte donc de ses choix lorsqu’il choisit au contraire de ne pas interrompre la production malgré des alertes provenant de multiples sources à FT. Le risque professionnel ne découle pas de l’activité industrielle mais est induit par les choix organisationnels et techniques de l’employeur. Cette notion de responsabilité de l’employeur crée simultanément à l’employeur des obligations sociales en matière de respect du droit. La directive européenne de 1989 avance que « l’employeur est obligé d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail » (Art. 5 de la directive 89/391 du 12 juin 1989).
Ici les employeurs et leurs représentants sont responsables au sens où ils avaient le pouvoir d’agir sur les choses. La juge interroge : « Avez-vous pu être force de proposition pour prévenir les risques psychosociaux ? » L’ordonnance de renvoi cible « un défaut de prise en compte des effets anxiogènes sur le personnel de la politique d’entreprise », malgré les alertes répétées.
Le jugement en première instance avait rappelé les fonctions du droit pénal, « celles d’incriminer les actes qui portent atteinte aux valeurs qui fondent le vivre ensemble (la vie, la personne, les biens, la Nation), d’assurer l’effectivité des règles sociales et d’imposer certains comportements en punissant leur non-respect. » Mais pourtant, au regret de nombreux militants, l’homicide involontaire avait été écarté pour cibler davantage la politique de l’entreprise prenant la forme d’un harcèlement institutionnel : « L’infraction d’homicide involontaire suppose la démonstration d’un lien de causalité certain, même non exclusif, mais néanmoins certain entre la faute reprochée à la personne mise en cause et le dommage. En l’espèce, il aurait fallu démontrer l’existence d’un lien de causalité certain entre la mise en place d’une politique de management ayant pour objet ou effet de dégrader les conditions de travail des salariés et le décès des victimes. »
Procès donc en demi-teinte, n’allant pas jusqu’au bout de la mise en cause de ces dirigeants cyniques « prévenus », mais armant les salariés et syndicalistes d’une nouvelle caractérisation des politiques managériales, le « harcèlement institutionnel », punissable de prison.
Dépolitisation en pointant les erreurs de ces cadres, ou bien repolitisation autour de l’enjeu du décryptage de la relation de travail ?