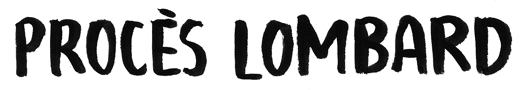Audience du 1er juillet vue par Maëlzig Bigi, sociologue, membre du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE), a travaillé notamment sur les questions de la reconnaissance au sein des organisations du travail.
Ce vendredi 1er juillet se déroule la dernière matinée d’audience du procès en appel France Télécom. Le public fait la queue pour entrer dans le tribunal, en face des touristes qui attendent pour visiter la Sainte Chapelle. Pendant ce temps, des barrières de sécurité sont enlevées du boulevard du Palais, derniers signes du tumulte du procès historique des attentats du 13 novembre, dont le verdict a été rendu l’avant-veille.
La salle d’audience, richement ornée, chargée d’histoire, tranche avec la sobriété clinique du nouveau TGI de la porte de Clichy où s’est tenu le premier procès il y a trois ans.

Maitre Veil y semble d’ailleurs plus à sa place quand il développe la première des trois plaidoiries en faveur de la relaxe de Monsieur Lombard. Lente et sophistiquée, celle-ci flotte autour d’une idée simple : son client n’est pas responsable, c’est l’Etat qui l’est. On aurait pu s’attendre à ce que l’avocat rappelle alors que, depuis les années 1990 se déploie le « puzzle doctrinal » du New Public Management, qui vise, par différents moyens, à réduire les dépenses publiques. Il s’agit notamment de privatiser, de mettre en concurrence, de rationaliser, de quantifier, de contrôler, dans l’espoir tout néo-libéral que cela permettra de faire mieux pour moins cher. On aurait pu s’attendre à ce que Maitre Veil évoque les transformations organisationnelles produites par le développement de la gouvernance actionnariale ou bien de la coupure de plus en plus grande entre un Etat stratège et le travail réel de ses opérateurs. Mais non, celui-ci a préféré affirmer tour à tour que la guerre en Ukraine invitait à construire une Europe de la défense, que son client, néanmoins grand visionnaire, était « prisonnier dans cette affaire », et que l’histoire de France Telecom était celle d’un déterminisme technologique implacable. Passons sur les moments gênants où l’avocat a annoncé à la disparition des petits garages dans les villages ainsi que des réparateurs de chaudières, allant jusqu’à proposer à l’avocate générale, de manière fort déplacée, de venir lui réparer sa chaudière.
Une fois ces éléments d’ambiance posés, la seconde plaidoirie a débuté, toute entière filée autour de la métaphore du Tour de France et, cette fois-ci, fondée sur l’examen des preuves. D’après Maitre Bérénice de Warren, malgré le travail acharné mené pendant quatre ans par un inspecteur qu’elle a jugé « obsédé par Lombard », seuls deux agissements concrets ont pu être établis. Ces agissements n’étant donc, d’après elle, pas répétés, il ne pourrait y avoir de harcèlement puisque celui-ci se caractérise par la durée et la répétition. Comment les objectifs de déflation des effectifs fixé par Monsieur Lombard ont-ils pu être mis en œuvre sans son concours ni même sa connaissance ? Grace à la délégation de pouvoir. Ainsi, il y aurait d’un côté, un patron stratège, sauveur de l’entreprise mais totalement ignorant des sujets relevant des ressources humaines – à l’exception notable du suivi du nombre de départs et d’arrêts maladies mensuels – et de l’autre, les exécutants des basses œuvres. S’il est difficile de croire à une si étanche séparation des pouvoirs, l’argumentaire de Maitre de Warren souligne toutefois l’importance des traces écrites dans l’administration de la preuve. Pour les syndicalistes qui défendent les salariés en situation de souffrance au travail, cela rappelle l’importance de la rédaction de textes (comptes rendus, tracts, alertes, rapports, etc.) qui pourraient être opposés à l’argument de l’ignorance.
C’est maitre Escartine qui, pour finir, se charge de la plaidoirie la plus stratégique, celle qui attaque la notion de harcèlement moral institutionnel. C’est en effet en cela que le premier procès France Telecom représente un progrès dans le traitement judiciaire des atteintes à la santé au travail. En 2019, la justice a posé que le harcèlement moral pouvait ne pas s’inscrire dans le cadre de relations interpersonnelles mais au contraire prendre la forme d’une politique d’entreprise, par exemple lorsque celle-ci vise à dégrader les conditions de travail d’un vaste ensemble de salarié·e·s. Maître Escartine reconnaît volontiers l’existence du harcèlement collectif dans la mesure où une seule et même personne peut tout à fait harceler plusieurs personnes individuellement au cours de la même période. Mais le harcèlement institutionnel n’est pas le harcèlement collectif. Le premier est bien trop dangereux car en rompant avec une définition exclusivement interpersonnelle du harcèlement, il ouvre la possibilité d’établir un lien juridique entre souffrance au travail et politiques managériales. Si le premier jugement se voyait confirmé, les dirigeant·e·s auraient potentiellement à faire face aux conséquences humaines de leurs décisions, ce que personne ne souhaite du côté des prévenus.
Après les ultimes déclarations de Messieurs Lombard et Wenès, la présidente conclut. Celle-ci prévient les deux parties qu’avec des points de vue aussi diamétralement opposés, son jugement fera nécessairement des mécontents. Rendez-vous le 30 septembre au matin pour le verdict !